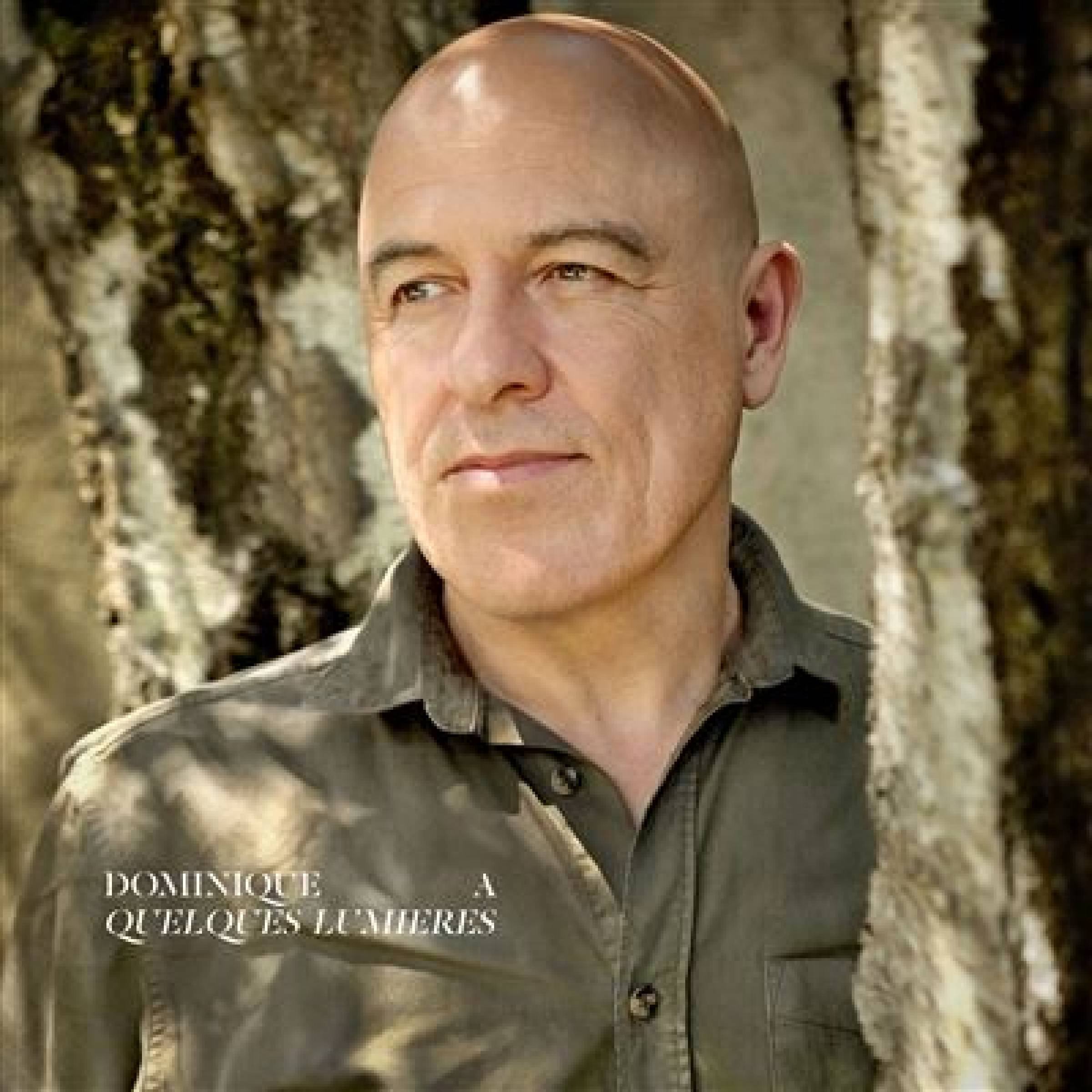De retour dans la vraie vie, des lignes encore, et des images pour me donner envie de me recoltiner avec ma marotte de critique frustré. De quel droit, me dira-t-on, me permets-je de juger le travail d'autrui sur la toile ? Du même qui permet à d'autres de juger du mien, sans doute. Dieu sait que j'ai pesté par le passé contre les critiques rock qui passaient de l'autre côté du miroir. Alors, que penser d'un chanteur qui joue au critique? Ce que bon vous semble, les amis, ce que bon vous semble. Mais il semblerait que l'exercice n'est pas inutile, quelques personnes m'ayant remercié de les avoir aiguillés sur telle ou telle chose, des livres notamment, bizarrement. Le jeu en vaut donc la bougie.
 Puissent alors les quelques lignes qui suivent vous donner l'envie de vous intéresser au roman de François Vergne, "Vie Nouvelle " (Gallimard), paru il y a deux petits mois et donc théoriquement disponible (je dis théoriquement, puisque au niveau écrémage express, le livre n'a rien à envier au disque ou au film : quand ça décolle pas dans la demi heure, ça dégage). C'est un livre très prégnant, quelques semaines encore après sa lecture, alors même que c'est le genre d'oeuvre dont on se demande au bout de deux pages si on va lire la troisième. Parce que l'écriture y est blanche de chez blanche (ou alors, c'est possible, je n'ai peut-être pas encore lu assez de livres), d'une neutralité extrême pour décrire par le menu l'existence d'une adolescente en province en France, existence pâle, si elle n'était placée sous le signe de l'abscence, de la mort de la mère, tout juste évoquée, mais dont la disparition énigmatique donne aux choses du quotidien comme un trop plein de présence, et ne fait que souligner le manque, et de la personne et du sens des choses. A force de dire la vie telle qu'elle est, dans ses manifestations extérieures, dans son décor de zones commerçantes, où on serait bien en peine justement de donner une signification à ce qui traverse une existence, de zones pavillonnaires et de grands ensembles, la réalité, teintée d'un trop plein d'elle même, semble atteindre à une sorte de sur-réalité, qui n'a rien à voir avec le réalisme poétique et son côté rassurant, mais où un autre type de poésie affleure, une poésie absolument ignorante d'elle même et indifférente de ses effets. Pas d'effets de manche, pas de ressort dramatique, ni de psychologie complaisante sur la vie des" moins-bien-lotis", rien qui vienne mettre à mal l'édifice délicat d'une écriture qui s'efface derrière ce qu'elle dépeint sans surjouer cet effacement et laisse finalement le sentiment d'une beauté absurde, drapée dans un quotidien fade mais hanté. On est loin de l'apologie des p'tites choses, des p'tits riens du quotidien qui font bobo à l'âme mais que ça réchauffe d'en parler, en vogue chez les chanteurs français; la comparaison semble tenir du coq à l'âne, oui, mais quand même, l'enjeu, de parler de la vie, du quotidien sans les réduire à leurs ressorts psychologiques, sans en éluder la part de mystère, concerne aussi l'écriture de textes de chansons.
Puissent alors les quelques lignes qui suivent vous donner l'envie de vous intéresser au roman de François Vergne, "Vie Nouvelle " (Gallimard), paru il y a deux petits mois et donc théoriquement disponible (je dis théoriquement, puisque au niveau écrémage express, le livre n'a rien à envier au disque ou au film : quand ça décolle pas dans la demi heure, ça dégage). C'est un livre très prégnant, quelques semaines encore après sa lecture, alors même que c'est le genre d'oeuvre dont on se demande au bout de deux pages si on va lire la troisième. Parce que l'écriture y est blanche de chez blanche (ou alors, c'est possible, je n'ai peut-être pas encore lu assez de livres), d'une neutralité extrême pour décrire par le menu l'existence d'une adolescente en province en France, existence pâle, si elle n'était placée sous le signe de l'abscence, de la mort de la mère, tout juste évoquée, mais dont la disparition énigmatique donne aux choses du quotidien comme un trop plein de présence, et ne fait que souligner le manque, et de la personne et du sens des choses. A force de dire la vie telle qu'elle est, dans ses manifestations extérieures, dans son décor de zones commerçantes, où on serait bien en peine justement de donner une signification à ce qui traverse une existence, de zones pavillonnaires et de grands ensembles, la réalité, teintée d'un trop plein d'elle même, semble atteindre à une sorte de sur-réalité, qui n'a rien à voir avec le réalisme poétique et son côté rassurant, mais où un autre type de poésie affleure, une poésie absolument ignorante d'elle même et indifférente de ses effets. Pas d'effets de manche, pas de ressort dramatique, ni de psychologie complaisante sur la vie des" moins-bien-lotis", rien qui vienne mettre à mal l'édifice délicat d'une écriture qui s'efface derrière ce qu'elle dépeint sans surjouer cet effacement et laisse finalement le sentiment d'une beauté absurde, drapée dans un quotidien fade mais hanté. On est loin de l'apologie des p'tites choses, des p'tits riens du quotidien qui font bobo à l'âme mais que ça réchauffe d'en parler, en vogue chez les chanteurs français; la comparaison semble tenir du coq à l'âne, oui, mais quand même, l'enjeu, de parler de la vie, du quotidien sans les réduire à leurs ressorts psychologiques, sans en éluder la part de mystère, concerne aussi l'écriture de textes de chansons.
 Dans des registres très sensiblement différents, j'aurais aussi aimé vous toucher deux mots d'autres livres, tel ce "Carnet de bal d'une courtisane" de Grisélidis Réal que m'ont aimablement adressé les éditions Verticales, un petit brulôt d'une ex prostituée, militant pour la reconnaissance de son métier, revendiquant la prostitution comme, je la cite,"une science, un art et un humanisme", et où sont consignés de façon lapidaire le prénom, us et coutumes sexuelles de ses anciens clients. Ca dépote, et le livre mériterait qu'on s'y attarde davantage; mais pour l'heure, j'ai surtout envie de vous parler de bandes dessinées, parce que c'est surtout sur ça que je me suis abîmé les yeux, de retour dans la vie normale. Avec, en tout premier lieu, les 18 volumes de "Monster", manga culte de Naoki Urasawa (Big Kana ed.),
Dans des registres très sensiblement différents, j'aurais aussi aimé vous toucher deux mots d'autres livres, tel ce "Carnet de bal d'une courtisane" de Grisélidis Réal que m'ont aimablement adressé les éditions Verticales, un petit brulôt d'une ex prostituée, militant pour la reconnaissance de son métier, revendiquant la prostitution comme, je la cite,"une science, un art et un humanisme", et où sont consignés de façon lapidaire le prénom, us et coutumes sexuelles de ses anciens clients. Ca dépote, et le livre mériterait qu'on s'y attarde davantage; mais pour l'heure, j'ai surtout envie de vous parler de bandes dessinées, parce que c'est surtout sur ça que je me suis abîmé les yeux, de retour dans la vie normale. Avec, en tout premier lieu, les 18 volumes de "Monster", manga culte de Naoki Urasawa (Big Kana ed.),  18 tomes enfilés comme des perles, impossible de rien lâcher en route, incroyable thriller qu'il serait vain de résumer en deux lignes (bonjour la dérobade), non, juste signaler que je n'ai jamais lu une intrigue pareille en B.D., sur cette longueur qui plus est, aussi touffuse que cohérente, cauchemar éveillé où on notera, comme chez Taniguchi dans un autre genre, la surdramatisation en plus, le talent des mangakas à donner à leurs personnages un maximum d'expressivité, quand bien même ces personnages font figure de stéréotypes. Le dessin n'est pas spécialement "beau", mais la maîtrise du trait, parfaitement synchrone avec celle du récit, est impressionnante. Je sens que tous mes à-prioris sur le manga sont en train de tomber à grande vitesse.
18 tomes enfilés comme des perles, impossible de rien lâcher en route, incroyable thriller qu'il serait vain de résumer en deux lignes (bonjour la dérobade), non, juste signaler que je n'ai jamais lu une intrigue pareille en B.D., sur cette longueur qui plus est, aussi touffuse que cohérente, cauchemar éveillé où on notera, comme chez Taniguchi dans un autre genre, la surdramatisation en plus, le talent des mangakas à donner à leurs personnages un maximum d'expressivité, quand bien même ces personnages font figure de stéréotypes. Le dessin n'est pas spécialement "beau", mais la maîtrise du trait, parfaitement synchrone avec celle du récit, est impressionnante. Je sens que tous mes à-prioris sur le manga sont en train de tomber à grande vitesse.
 La B.D. italienne fait belle figure ces temps-ci, comme en attestent les deux numéros de la revue Black, et qui outre, et parmi d'autres, Gabriella Giandelli (auteur du magnifique "Sous les arbres", que je ne saurais trop que vous re-recommander), a révélé en France et Belgique le talent du dénommé Gipi; Gipi, dont on édite aujourd'hui "Les innocents" (Coconino Press-Vertige Graphic, également éditeurs, décidément, d'un très beau nouveau livre de Giandelli, "Interiorae"), courte histoire très triste et très juste, où un homme rend avec son jeune neveu visite à un ancien camarade, victime de persécutions policières. Le dessin, magistral, n'est pas sans évoquer celui de Baru, en plus
La B.D. italienne fait belle figure ces temps-ci, comme en attestent les deux numéros de la revue Black, et qui outre, et parmi d'autres, Gabriella Giandelli (auteur du magnifique "Sous les arbres", que je ne saurais trop que vous re-recommander), a révélé en France et Belgique le talent du dénommé Gipi; Gipi, dont on édite aujourd'hui "Les innocents" (Coconino Press-Vertige Graphic, également éditeurs, décidément, d'un très beau nouveau livre de Giandelli, "Interiorae"), courte histoire très triste et très juste, où un homme rend avec son jeune neveu visite à un ancien camarade, victime de persécutions policières. Le dessin, magistral, n'est pas sans évoquer celui de Baru, en plus  apaisé cela dit, moins paroxystique. Baru, justement, dont on réédite chez Casterman avec bonheur (très belle réimpression des couleurs), son "Quéquette Blues" d'anthologie, qui porte avec superbe ses 25 ans d'âge; y sont narrées les mésaventures de jeunes hommes, un soir de jour de l'an dans les années soixante dans une petite ville du nord de la France, uniquement affairés à perdre leur pucelage; ça pourrait être mince comme du papier à rouler, si l'ambiance n'y était si forte, imprégnée d'une nostalgie dûre, loin du doux amer souvent inhérent à l'auto-fiction.
apaisé cela dit, moins paroxystique. Baru, justement, dont on réédite chez Casterman avec bonheur (très belle réimpression des couleurs), son "Quéquette Blues" d'anthologie, qui porte avec superbe ses 25 ans d'âge; y sont narrées les mésaventures de jeunes hommes, un soir de jour de l'an dans les années soixante dans une petite ville du nord de la France, uniquement affairés à perdre leur pucelage; ça pourrait être mince comme du papier à rouler, si l'ambiance n'y était si forte, imprégnée d'une nostalgie dûre, loin du doux amer souvent inhérent à l'auto-fiction.
 Enfin, glissons un mot du dernier Lewis Trondheim, le surprenant "Désoeuvré" à l'Association. Il y rapporte avec brio la crise d'inspiration qu'il traverse, et tente de résoudre en se livrant à une surprenante petite enquête sur les crises similaires vécues par des auteurs et dessinateurs de B.D.; il en ressort, entre autres, qu'au sein de la fameuse école belge des années 50-70, les dessinateurs de Tintin étaient des obsédés sexuels, et ceux de Spirou des dépressifs (et vlan dans la gueule des souvenirs).
Enfin, glissons un mot du dernier Lewis Trondheim, le surprenant "Désoeuvré" à l'Association. Il y rapporte avec brio la crise d'inspiration qu'il traverse, et tente de résoudre en se livrant à une surprenante petite enquête sur les crises similaires vécues par des auteurs et dessinateurs de B.D.; il en ressort, entre autres, qu'au sein de la fameuse école belge des années 50-70, les dessinateurs de Tintin étaient des obsédés sexuels, et ceux de Spirou des dépressifs (et vlan dans la gueule des souvenirs).

 Preuve à l'appui, je suis tombé sur une longue interview de Willy Lambil, dessinateur des Tuniques Bleues, dans laquelle celui-ci rapporte sa période dépressive, due à un manque de considération des gens du métier pour son travail pourtant largement plébiscité par le public. Et, buvons la coupe jusqu'à la lie, dans la série "pas-facile-décidément-d'être-un dessinateur-de-petits-mickeys", on terminera sur le sujet en évoquant "L'affaire belge", le dernier Canardo, série jadis brillante de Sokal, qui se propose de dresser un portrait au vitriol du monde de la bande dessinée, mais le fait avec bien peu d'élégance et d'à-propos, avec une aigreur qui sent le règlement de comptes envers un milieu qu'il ne cotoie sans doute plus que de loin, ayant entretemps connu la réussite dans celui de la conception de jeux vidéos. Même pas drôle.
Preuve à l'appui, je suis tombé sur une longue interview de Willy Lambil, dessinateur des Tuniques Bleues, dans laquelle celui-ci rapporte sa période dépressive, due à un manque de considération des gens du métier pour son travail pourtant largement plébiscité par le public. Et, buvons la coupe jusqu'à la lie, dans la série "pas-facile-décidément-d'être-un dessinateur-de-petits-mickeys", on terminera sur le sujet en évoquant "L'affaire belge", le dernier Canardo, série jadis brillante de Sokal, qui se propose de dresser un portrait au vitriol du monde de la bande dessinée, mais le fait avec bien peu d'élégance et d'à-propos, avec une aigreur qui sent le règlement de comptes envers un milieu qu'il ne cotoie sans doute plus que de loin, ayant entretemps connu la réussite dans celui de la conception de jeux vidéos. Même pas drôle.
 Les yeux papillotant, les ouïes prirent la relève. La moisson fût moins faste que les mois précédents, mais quand même... Les amabilités commencèrent avec la plage n°3 du disque d' Electrelane, "The power out" sorti il y a quelques mois, et acquis sur les conseils réitérés d'Yvan, co-créateur du site sur lequel vous vous trouvez présentement. La chanson en question s'appelle "The valley", et on pourrait, si on voulait s'amuser, la présenter comme de l'épique lo-fi, avec petits moyens mais chorale conquérante, les dix commandements ou tout au moins l'épopée des pionniers d'Amérique en ligne de mire, avec de possibles réminiscences des Raincoats et de leur merveilleux" Odyshape" que produisit Robert Wyatt sur Rough Trade, auberge espagnole ethno-folk plus qu'inspirée et très en avance sur son époque (1981). Pour en revenir à Electrelane, le reste de l'album, plus conventionnellement indie-foutraque (pas sur Too Pure par hasard), n'est pas, à mon humble avis, mais fais-je autre chose que vous le livrer donc pourquoi le préciser ?, à la hauteur, mais devient assez rapidement assez jouissif ( 2, 3 écoutes, s'il est encore des gens pour avoir cette patience).
Les yeux papillotant, les ouïes prirent la relève. La moisson fût moins faste que les mois précédents, mais quand même... Les amabilités commencèrent avec la plage n°3 du disque d' Electrelane, "The power out" sorti il y a quelques mois, et acquis sur les conseils réitérés d'Yvan, co-créateur du site sur lequel vous vous trouvez présentement. La chanson en question s'appelle "The valley", et on pourrait, si on voulait s'amuser, la présenter comme de l'épique lo-fi, avec petits moyens mais chorale conquérante, les dix commandements ou tout au moins l'épopée des pionniers d'Amérique en ligne de mire, avec de possibles réminiscences des Raincoats et de leur merveilleux" Odyshape" que produisit Robert Wyatt sur Rough Trade, auberge espagnole ethno-folk plus qu'inspirée et très en avance sur son époque (1981). Pour en revenir à Electrelane, le reste de l'album, plus conventionnellement indie-foutraque (pas sur Too Pure par hasard), n'est pas, à mon humble avis, mais fais-je autre chose que vous le livrer donc pourquoi le préciser ?, à la hauteur, mais devient assez rapidement assez jouissif ( 2, 3 écoutes, s'il est encore des gens pour avoir cette patience).
 Dernièrement, je traînais mes guêtres en Andalousie (à ce propos, saviez-vous que Séville est une fête, bien plus que Paris, et possiblement une des plus belles villes du monde ?), où Rafa de Green Ufo's, le label sévillanais qui distribue en Espagne les oeuvres d'innombrables gaulois, dont les miennes, (et également nombre d'anglo-saxons, dont Antony and the Johnsons qui fait un carton là bas), Rafa, donc, m'a remis en mains propres le dernier Piano Magic, "Disaffected", distribué en France par le vaillant et avisé label Talitres. J'avais partagé l'affiche à deux reprises avec Piano Magic, en 99 et l'an dernier, et les deux fois j'avais pensé "bof bof". Un de leurs disques m'avait cependant accompagné tout un mois d'été, "Writers without homes", leur chant du cygne chez 4 AD, avec notamment un long morceau contemplatif magnifiquement porté par la voix de John Grant des Czars, un piano pointilliste de Simon Raymonde et des
Dernièrement, je traînais mes guêtres en Andalousie (à ce propos, saviez-vous que Séville est une fête, bien plus que Paris, et possiblement une des plus belles villes du monde ?), où Rafa de Green Ufo's, le label sévillanais qui distribue en Espagne les oeuvres d'innombrables gaulois, dont les miennes, (et également nombre d'anglo-saxons, dont Antony and the Johnsons qui fait un carton là bas), Rafa, donc, m'a remis en mains propres le dernier Piano Magic, "Disaffected", distribué en France par le vaillant et avisé label Talitres. J'avais partagé l'affiche à deux reprises avec Piano Magic, en 99 et l'an dernier, et les deux fois j'avais pensé "bof bof". Un de leurs disques m'avait cependant accompagné tout un mois d'été, "Writers without homes", leur chant du cygne chez 4 AD, avec notamment un long morceau contemplatif magnifiquement porté par la voix de John Grant des Czars, un piano pointilliste de Simon Raymonde et des  grondements de tonnerre étrangement doux et rassurants, et c'est un phobique de l'orage qui vous cause (un astrapéphobe, pour être précis). Trois ans plus tard, la cause est toujours perdue, mais avec de très beaux restes. "Disaffected", avec sa Closer-ite aigüe, ses guitares liquéfiées à la And Also The Trees, ses sentences top dep' (l'impayable "Anything can happen in life, especially nothing, mainly nothing"; wow...et après ?), est un beau disque d'adolescence qui n'en finit pas de finir mais a oublié de geindre pour passer à l'attaque, cornes en avant, juste un peu dilué sur le tard, dommage. C'est parfois un poil trop blanc sur blanc (la voix), ou noir sur noir (les mots), comme on voudra, on aurait parfois envie de leur chatouiller un peu les pieds (comme me l'avait rapporté un bon ami resté 8 heures durant avec eux dans un camion : 8 heures sans un mot, c'est long). Mais quand même, beau disque, qui malgré le parti pris assumé de "nostalgist" (titre d'une des chansons), sonne étrangement assez antidaté.
grondements de tonnerre étrangement doux et rassurants, et c'est un phobique de l'orage qui vous cause (un astrapéphobe, pour être précis). Trois ans plus tard, la cause est toujours perdue, mais avec de très beaux restes. "Disaffected", avec sa Closer-ite aigüe, ses guitares liquéfiées à la And Also The Trees, ses sentences top dep' (l'impayable "Anything can happen in life, especially nothing, mainly nothing"; wow...et après ?), est un beau disque d'adolescence qui n'en finit pas de finir mais a oublié de geindre pour passer à l'attaque, cornes en avant, juste un peu dilué sur le tard, dommage. C'est parfois un poil trop blanc sur blanc (la voix), ou noir sur noir (les mots), comme on voudra, on aurait parfois envie de leur chatouiller un peu les pieds (comme me l'avait rapporté un bon ami resté 8 heures durant avec eux dans un camion : 8 heures sans un mot, c'est long). Mais quand même, beau disque, qui malgré le parti pris assumé de "nostalgist" (titre d'une des chansons), sonne étrangement assez antidaté.
 Remarque valable aussi pour le deuxième disque de Bastien Lallemant, tout frais sorti du moule chez Tôt ou Tard, et aussi habillé, avec des parures chatoyantes, que le précédent était nu. Bonnes mélodies, belles colorations d'arrangements (Bertrand Belin, Simon Edwards, Albin de la Simone, entre autres enlumineurs), latines voire éthiopiennes. J'aime bien ce garçon, ses manières pas maniérées, sa voix bien posée, et son vocabulaire désuet (des mots comme "félonie" et "vilennies" émaillent ses textes), et qui se propose moins de faire vibrer la fibre de "l'Age d'Or" que de refuser la vulgarité contemporaine; il y a là plus de résistance que de fuite.
Remarque valable aussi pour le deuxième disque de Bastien Lallemant, tout frais sorti du moule chez Tôt ou Tard, et aussi habillé, avec des parures chatoyantes, que le précédent était nu. Bonnes mélodies, belles colorations d'arrangements (Bertrand Belin, Simon Edwards, Albin de la Simone, entre autres enlumineurs), latines voire éthiopiennes. J'aime bien ce garçon, ses manières pas maniérées, sa voix bien posée, et son vocabulaire désuet (des mots comme "félonie" et "vilennies" émaillent ses textes), et qui se propose moins de faire vibrer la fibre de "l'Age d'Or" que de refuser la vulgarité contemporaine; il y a là plus de résistance que de fuite.
 Tout aussi lumineux et hautement recommandable, le dernier Tarwater, mon groupe électro favori avec Pan Sonic, "The needle was travelling", avec le plus talentueux des chanteurs non expressifs (je n'ai pas dit inexpressif, mais désexpressif n'existe pas, et il faut bien essayer de se faire comprendre), j'ai nommé Ronald Lippok; ils ont vraiment une façon très organique et ludique d'envisager la musique électronique qui n'appartient qu'à eux, et jamais depuis "Silur", leur masterpiece de 1998, ça n'avait paru aussi évident. Grand Cru. Et fin du blabla pour aujourd'hui, ça brille dehors, enfin.
Tout aussi lumineux et hautement recommandable, le dernier Tarwater, mon groupe électro favori avec Pan Sonic, "The needle was travelling", avec le plus talentueux des chanteurs non expressifs (je n'ai pas dit inexpressif, mais désexpressif n'existe pas, et il faut bien essayer de se faire comprendre), j'ai nommé Ronald Lippok; ils ont vraiment une façon très organique et ludique d'envisager la musique électronique qui n'appartient qu'à eux, et jamais depuis "Silur", leur masterpiece de 1998, ça n'avait paru aussi évident. Grand Cru. Et fin du blabla pour aujourd'hui, ça brille dehors, enfin.
Bon dilemne à tous (Oui ? Non ? Rien à carrer ?)